Les procédés d’écriture littéraire sont comme des outils qui nous aident à mieux exprimer nos idées. Ils rendent ce qu’on dit plus intéressant et plus facile à comprendre. On les utilise souvent dans les livres, mais aussi dans les discours et même dans nos conversations de tous les jours.
Ces techniques ont un but important : elles rendent notre message plus fort et plus clair pour celui qui le reçoit. Que ce soit dans un texte écrit ou dans ce que nous disons, ces procédés nous aident à mieux partager nos pensées et à toucher ceux qui nous écoutent ou nous lisent.
Qu’est-ce qu’un procédé d’écriture ?
Les procédés d’écriture littéraire, c’est un peu comme des astuces qu’on utilise pour dire quelque chose de manière plus efficace et claire. En gros, c’est l’emploi de mots ou de tournures de phrases spéciales pour donner plus de force à ce qu’on veut exprimer.
Ces procédés stylistiques sont un genre de ‘truc’ rhétorique qui nous aide à créer des images dans l’esprit de ceux qui nous écoutent ou nous lisent. Quand on dit ‘figure sur le fond’, ça veut dire que ces procédés ont un sens plus profond que ce qu’on entend juste à la surface.
On retrouve souvent ces procédés dans la poésie, les textes narratifs et même dans les paroles de chansons. Ils servent à renforcer une idée ou à mettre en avant un mot ou une phrase particulière.
Procédés d’écriture : exemple
Les procédés d’écriture littéraire sont couramment utilisés dans la langue de tous les jours. Ils ajoutent de la couleur et de la profondeur à l’écriture et aident à créer une image plus vive. Voici quelques exemples de procédés d’écriture :
- Le roi des animaux.
- La ville rose.
- Je meurs de soif
- Mon épouse est un peu enveloppée
- La terre est bleue comme une orange. (Eluard)
- Il pleut des cordes.
- Je viens de boire un verre.
- Il nous a quittés (= mort)
Les procédés d’écriture et leurs effets
Vous trouverez ci-dessous une liste des différents procédés littéraires et leurs effets :
1. Le champ lexical
Le champ lexical d’un texte, c’est comme une palette de couleurs utilisée par un peintre, mais avec des mots. Cela concerne quels mots sont choisis, combien de fois ils apparaissent, et comment ils sont utilisés pour donner du sens au texte.
Quand on parle de champ lexical, on regarde surtout combien de fois certains mots sont répétés et la façon dont ils sont choisis pour s’adapter au sujet. Par exemple, si un texte parle de la peur, on va trouver des mots comme ‘effroi’, ‘angoisse’ ou ‘frisson’.
En bref, le lexique et procédés particuliers d’un texte, c’est un ensemble de mots qui tournent autour d’un même sujet ou thème, comme la bonté, la peur, la paix, l’identité, ou la guerre.
2. La dénotation
La dénotation, c’est comme la définition d’un mot que vous trouvez dans un dictionnaire. C’est le sens direct et simple du mot, sans aucune interprétation.
Pour le dire autrement, la dénotation c’est la signification de base d’un mot, celle que tout le monde comprend de la même manière. C’est le sens que vous trouvez dans un dictionnaire, sans rien ajouter ou imaginer.
Ce sens dénoté est surtout utilisé dans des textes qui donnent des informations claires et précises, comme dans les dictionnaires, les guides touristiques, les manuels d’utilisation, ou les articles scientifiques.
Exemple de la dénotation :
- Le nom « rouge » désigne une couleur pour tous les francophones.
- Le mot « lune » désigne une pièce contenant de l’eau
3. La connotation
La connotation, c’est une sorte de sens caché ou supplémentaire d’un mot, qui va au-delà de sa définition de base. C’est un sens qui change selon les personnes ou la situation. Par exemple, le mot ‘rose’ peut juste désigner une fleur (sa dénotation), mais il peut aussi évoquer l’amour ou la beauté (sa connotation).
En gros, la connotation, c’est ce que le mot évoque pour vous personnellement, ou dans un contexte particulier. Les textes littéraires, comme les romans ou les poèmes, sont remplis de mots avec des connotations fortes, car ils utilisent souvent le langage de manière créative pour provoquer des émotions ou des images dans l’esprit du lecteur.
Exemple de la connotation :
- blanc connote la pureté ou l’innocence ou la froideur.
- ville couchée : signifie la paix, le calme, le silence ; mais aussi la mort.
- Il me promet la lune. Le mot « lune » connote ici l’éloignement.
4. Le vocabulaire mélioratif et péjoratif
- Le vocabulaire mélioratif
Le vocabulaire mélioratif, c’est comme un ensemble de mots qui font des compliments. Quand on utilise ce genre de vocabulaire, on choisit des mots qui donnent une image positive de quelque chose ou de quelqu’un. C’est un peu comme quand on décrit un endroit de manière à ce qu’il semble très agréable ou quand on parle d’une personne pour montrer qu’on l’apprécie beaucoup.
Des exemples de mots mélioratifs sont ‘beau’, ‘gracieux’, ou ‘élégance’. Ces mots expriment une opinion positive, comme si on disait du bien de quelque chose ou de quelqu’un. On les utilise pour montrer qu’on trouve quelque chose de bien ou d’agréable.
- Le vocabulaire péjoratif
Le vocabulaire péjoratif, c’est l’opposé du vocabulaire mélioratif. Ici, on utilise des mots qui expriment un jugement négatif sur quelque chose ou quelqu’un. Ces mots montrent qu’on ne trouve pas quelque chose de bien ou d’agréable.
Des exemples de mots péjoratifs sont ‘désagréable’, ‘ennui’, ou ‘laideur’. Ces mots donnent une opinion défavorable. Par exemple, si on décrit un lieu comme ‘désagréable’, on fait comprendre qu’il n’est pas plaisant à être.
Le mot ‘péjoratif’ vient du latin ‘pejor’, qui signifie ‘plus mauvais’. Donc, quand on utilise un vocabulaire péjoratif, c’est pour donner une image négative ou montrer qu’on a une mauvaise opinion de quelque chose ou de quelqu’un.
5. La comparaison
La comparaison établit un rapport de ressemblance entre deux éléments (le comparé et le comparant), à l’aide d’un outil de comparaison (comme, ainsi que, plus… que, moins… que, de même que, semblable à, pareil à, ressembler, on dirait que…)
Exemple de la comparaison :
- L’avion est plus rapide que la voiture.
- Tom nage comme un poisson.
- Mon ami est très rapide comme l’éclair.
6. La métaphore
La métaphore, c’est comme une comparaison, mais un peu différente. Imaginez que vous comparez deux choses sans dire ‘comme’ ou ‘tel que’. Parfois, on ne mentionne même pas clairement ce à quoi on compare l’objet.
Dans une métaphore, il y a deux parties principales : ce qu’on décrit (le comparé) et à quoi on le compare (le comparant). Les deux doivent avoir quelque chose en commun, mais au lieu de dire clairement qu’ils sont similaires, on fait comme si l’un était l’autre.
Par exemple, si on dit ‘le temps est un voleur’, on compare le temps à un voleur sans utiliser le mot ‘comme’. Ici, ‘le temps’ est le comparé et ‘un voleur’ est le comparant. On sous-entend que le temps vole quelque chose, comme le fait un voleur, sans le dire directement.
Exemple de métaphore :
- Cet homme est un rat de bibliothèque.
- ses yeux de statue.
7. La personnification
La personnification, c’est quand on donne des traits humains à quelque chose qui n’est pas humain, comme un objet, un animal, ou même une idée. On leur attribue des émotions, des pensées, ou une forme physique comme si c’étaient des personnes.
Par exemple, quand on dit que les objets inanimés ou les animaux font des choses que normalement seuls les humains font, on utilise la personnification. Comme dire qu’un arbre ‘danse’ dans le vent, on imagine l’arbre bougeant comme une personne qui danse.
La personnification est une sorte de métaphore. Elle aide à rendre des idées ou des concepts abstraits plus concrets et faciles à comprendre pour nous, en les décrivant de manière humaine.
Voici quelques exemples de la personnification :
- Les arbres tremblaient de joie
- Le ciel pleurait.
- Les arbres font le gros dos sous la pluie. — Jules Renard, Journal.
8. L’antithèse
L’antithèse est une façon de parler ou d’écrire où l’on met côte à côte deux idées, mots ou expressions qui sont complètement opposés. C’est comme dessiner un contraste très marqué entre deux choses pour les faire ressortir davantage.
Imaginez que dans une phrase, vous rapprochiez des éléments qui sont normalement à l’extrême opposé, pour créer un effet de surprise ou pour souligner une différence importante. Cela peut aussi servir à montrer de l’ironie, c’est-à-dire quand on dit quelque chose mais qu’en réalité, on pense le contraire.
On trouve l’antithèse dans beaucoup de situations, comme dans les livres, les poèmes, et même dans nos discussions de tous les jours. Par exemple, une phrase comme ‘Il était brave mais lâche’ est une antithèse car ‘brave’ et ‘lâche’ sont des idées opposées.
Exemples de l’antithèse :
- « Être le jour qui monte et l’ombre qui descend ». Anna de Noailles
- Le navire était noir, mais la voile était blanche.
9. L’oxymore
Un oxymore, c’est une figure de style où on met ensemble deux mots qui se contredisent pour créer un effet spécial, un peu comme un mélange surprenant. Cela donne une expression qui semble contradictoire, mais qui a en fait un sens plus profond.
On utilise l’oxymore pour provoquer de l’ironie ou de la surprise. C’est une façon de montrer qu’il y a des sentiments ou des idées complexes qui ne peuvent pas être décrits avec un seul mot. Cela donne quelque chose de vraiment intéressant, car cela pousse à réfléchir sur le sens caché derrière ces mots opposés.
Par exemple, quand on dit ‘une douce violence’, c’est un oxymore. Les mots ‘douce’ et ‘violence’ sont normalement opposés, mais ensemble, ils créent une image ou une idée unique et intrigante.
- « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles » (Corneille)
- « une nuit blanche »
10. La métonymie
La métonymie est une figure de style où l’on remplace un mot par un autre qui lui est étroitement lié, mais d’une manière un peu différente. Cela se fait par un lien logique, comme l’appartenance, l’origine, ou un rapport de proximité.
Par exemple, quand on dit ‘Boire un verre’, on ne boit pas réellement le verre, mais le contenu du verre. Ici, ‘verre’ est utilisé pour désigner la boisson qu’il contient. C’est une métonymie car le verre et ce qu’il contient sont étroitement liés.
En gros, la métonymie, c’est utiliser un mot pour en remplacer un autre, non pas parce qu’ils signifient la même chose, mais parce qu’ils ont un rapport logique ou une association claire entre eux.
Exemples de la métonymie :
- « boire un verre » (le contenu [liquide] est remplacé par le contenant.
- « Il est sorti d’une Peugeot » [la marque remplace le nom de l’objet]
11. La périphrase
La périphrase, c’est une façon de dire quelque chose en utilisant une expression au lieu d’un seul mot. Au lieu de dire directement ce que l’on veut exprimer, on utilise une suite de mots qui décrit ou définit cette chose.
Par exemple, au lieu de dire ‘Paris’, on pourrait dire ‘la Ville Lumière’. Ici, ‘la Ville Lumière’ est une périphrase pour ‘Paris’. On n’utilise pas directement le nom ‘Paris’, mais une expression qui décrit une caractéristique célèbre de la ville.
En gros, avec la périphrase, on remplace un nom propre ou un nom commun par une expression descriptive. C’est une manière un peu plus poétique ou imaginative de parler de quelque chose.
Exemple de la périphrase :
- L’île de beauté pour la Corse.
- L’astre du jour », pour le Soleil.
12. L’antiphrase
L’antiphrase est une figure de style où on dit quelque chose mais en réalité, on veut dire exactement le contraire. C’est une façon courante d’exprimer de l’ironie.
Par exemple, si on dit ‘Quelle belle journée!’ alors qu’il pleut des cordes, on utilise l’antiphrase. On dit que la journée est belle, mais en fait, on veut montrer qu’elle est mauvaise à cause de la pluie.
Donc, en gros, avec l’antiphrase, les mots que l’on utilise ont un sens opposé à ce qu’ils veulent littéralement dire. C’est une manière de montrer qu’on pense le contraire de ce qu’on dit, souvent de manière humoristique ou sarcastique.
Exemples de l’antiphrase :
- Que tu es intelligent !
- « Quelle belle journée » [alors qu’il pleut et qu’il fait froid].
13. L’euphémisme
L’euphémisme est une façon de dire les choses moins directement pour éviter de choquer ou de blesser. On utilise des mots plus doux ou plus positifs pour remplacer des expressions qui pourraient être trop dures ou négatives.
C’est comme si on adoucissait la réalité pour la rendre moins brutale. Par exemple, dire ‘il nous a quittés’ au lieu de ‘il est mort’ est un euphémisme. On utilise une expression moins directe pour parler de la mort, ce qui la rend moins dure à entendre.
En outre, l’euphémisme peut aussi être utilisé pour ajouter de l’humour. On peut faire une exagération qui n’est pas censée être prise au sérieux, pour rendre quelque chose plus léger ou drôle. Mais le plus souvent, l’euphémisme sert à parler de choses difficiles de manière plus douce.
Exemples de l’euphémisme :
- « il nous a quittés » au lieu de « il est mort ».
- Être un peu limité : être bête.
- Non-voyant/non entendant : aveugle et sourd.
14. L’hyperbole
L’hyperbole, c’est comme utiliser un zoom puissant sur quelque chose en le rendant beaucoup plus grand ou plus intense que ce qu’il est réellement. C’est une manière d’exagérer énormément pour faire un effet.
Cette figure de style sert à montrer des émotions ou des idées de façon très forte, en les grossissant à l’extrême. Par exemple, si on dit ‘j’ai attendu une éternité’, on n’a évidemment pas attendu littéralement pour toujours, mais on exagère pour montrer qu’on a attendu très longtemps.
On utilise souvent l’hyperbole dans l’écriture pour rendre un point plus frappant ou pour exprimer des sentiments très forts. C’est comme dire les choses de manière super dramatique pour attirer l’attention ou pour partager de manière intense ce qu’on ressent ou ce qu’on pense.
Exemples de l’hyperbole :
- « je meurs de faim »
- « Verser des torrents de larmes »
15. La répétition
La répétition, c’est quand on utilise le même mot plusieurs fois dans un texte. Mais ces mots répétés ne sont pas juste à côté l’un de l’autre, ils sont éparpillés dans différentes parties de la phrase ou du texte.
C’est une technique utilisée pour attirer l’attention sur une idée importante. En répétant un mot, on rend ce point plus marquant et plus mémorable pour le lecteur. Cela permet de souligner ce que l’on veut vraiment mettre en avant.
En plus, la répétition peut être utilisée pour créer de l’humour ou du sarcasme. Par exemple, si on répète un mot de façon exagérée, cela peut devenir drôle ou ironique. C’est donc un moyen puissant pour rendre un texte plus vivant et plus impactant.
Exemples de la répétition :
- « La terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris » [Giono]
- Ô triste, triste était mon âme
À cause, à cause d’une femme.
– Verlaine
16. L’énumération [accumulation]
L’énumération, c’est comme faire une liste de mots qui sont du même type et qui ont des significations similaires. On aligne ces mots les uns après les autres dans une phrase.
L’effet de cette suite de mots, c’est comme si on augmentait le volume d’une musique : ça crée une impression de plus en plus forte. Cette accumulation de mots donne plus de poids à ce qu’on dit et rend le message plus marquant.
Par exemple, si on énumère ‘joie, bonheur, plaisir, allégresse’ pour parler de sentiments positifs, on renforce l’idée d’un sentiment très fort et agréable. C’est une manière d’accentuer ce qu’on veut exprimer, en ajoutant plusieurs mots qui tournent autour du même thème.
Exemple de l’énumération :
« Je m’en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu’aujourd’hui, la plus brillante, la plus digne d’envie… » [Lettre de Madame de Sévigné]
17. La gradation
La gradation, c’est quand on aligne des mots ou des expressions dans un ordre qui va du moins fort au plus fort, ou l’inverse. Cela crée une sorte d’escalade dans les idées ou les sentiments exprimés.
En utilisant la gradation, on augmente progressivement l’intensité de ce qu’on dit. Cela donne l’impression que chaque mot ou expression est plus fort que le précédent, ce qui rend le dernier terme particulièrement marquant.
Par exemple, une phrase comme ‘Il marchait, courait, volait presque’ est une gradation. On commence par une action simple (marcher) et on termine par une action de plus en plus intense (voler presque). C’est un moyen efficace pour rendre une description plus vivante et plus impressionnante.
Exemple de la gradation :
- « C’en est fait ; Je n’en puis plus, je me meurs, je suis mort , je suis enterré. » [L’Avare de Molière]
- « Je suis ravie, contente. Heureuse » [ascendante]
18. L’anaphore
L’anaphore, c’est une technique où l’on répète le même mot ou groupe de mots au début de plusieurs phrases ou lignes qui se suivent. C’est comme si on commençait chaque phrase de la même manière.
Par exemple, si on répète ‘Je rêve’ au début de chaque phrase d’un poème, comme ‘Je rêve de soleil, Je rêve de liberté’, c’est une anaphore. Cette répétition crée un effet particulier, elle attire l’attention sur ce qui vient après le mot ou le groupe de mots répété.
L’anaphore est utilisée pour souligner un point important ou pour créer un rythme dans un texte. Cela rend les mots qui suivent plus frappants et donne un rythme particulier au texte, ce qui peut le rendre plus mémorable ou plus puissant.
Anaphore : exemple
- « Marcher à jeun, marcher vaincu, marcher malade » [Hugo]
19. L’ellipse
L’ellipse, c’est une figure de style où on enlève des mots d’une phrase, mais le sens reste clair malgré leur absence. C’est comme si on sautait certains mots parce qu’on sait que le lecteur peut les comprendre sans qu’ils soient explicitement dits.
Par exemple, si on dit ‘Je suis allé au marché; ma sœur, à la bibliothèque’, on ne répète pas ‘est allée’ pour la sœur. On comprend le sens complet sans avoir besoin de tous les mots.
L’ellipse permet de rendre le texte plus dynamique et d’attirer l’attention sur certaines parties en omettant volontairement d’autres parties. C’est une manière de jouer avec les mots pour créer un style ou un effet particulier.
Exemple de l’ellipse :
Au lieu de « Heureux est celui qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage », Du Bellay écrit :
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage » Les Regrets, sonnet 31 1558, Joachim Du Bellay
20. Le parallélisme
Le parallélisme, c’est une figure de style où on utilise la même structure de phrase ou la même construction grammaticale dans différentes parties d’un texte. L’idée, c’est de montrer un lien ou une ressemblance entre ces différentes parties.
Par exemple, si on dit ‘Il aimait lire, elle aimait écrire’, on utilise une structure similaire pour les deux parties de la phrase. Cela crée un effet de symétrie et met en valeur le rapport ou la comparaison entre les deux idées.
En gros, le parallélisme, c’est comme dessiner une ligne imaginaire entre deux idées ou deux parties d’un texte pour montrer qu’elles sont connectées ou qu’elles se répondent. Cela rend le texte plus harmonieux et souligne les similitudes ou les contrastes entre les idées.
Exemple su parallélisme :
- Que la vie est belle ! Que la vie est tendre !
- L’un était pauvre, mais intelligent.
- L’autre était riche, mais ignorant.
Télécharger tableau des différents procédés d’écriture littéraire en PDF
LIRE AUSSI : La contraction de texte : méthode et exercice

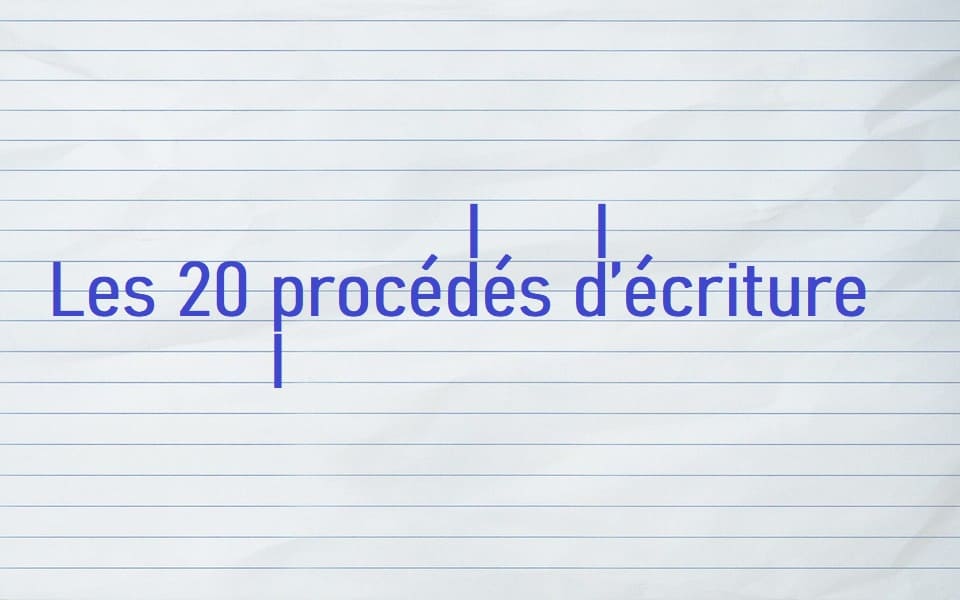
Laisser un commentaire